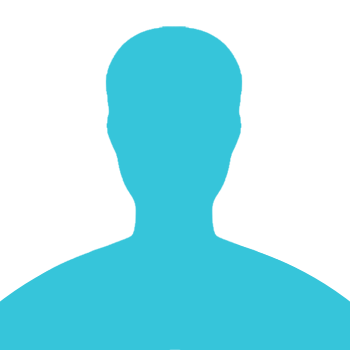Marque / Communication
Ceci n’est pas une crise
La période que nous traversons est complexe, anxiogène et remet en question nos certitudes et nos pratiques. Pour autant, est-ce une crise ?
Non, si l’on se réfère, comme c’est généralement le cas à l’acception médicale du terme : une phase, parfois annonciatrice ou révélatrice, toujours aigüe, d’une maladie. La crise est ...
La suite de l’article et le téléchargement sont réservés aux membres ou aux détenteurs de crédits
Vous êtes membre ou vous avez des crédits ?
Se connecterRejoindre l’IREP
- Accédez à l’ensemble de la base Com’Search
- Participez aux events de l’IREP toute l’année
- Échangez et networkez avec le réseau
Acheter le contenu
Vous pouvez acheter uniquement ce contenu ou des packs de crédits pour plusieurs contenus de la base Com’search.
Acheter le contenu